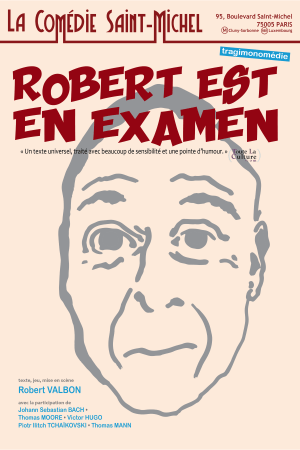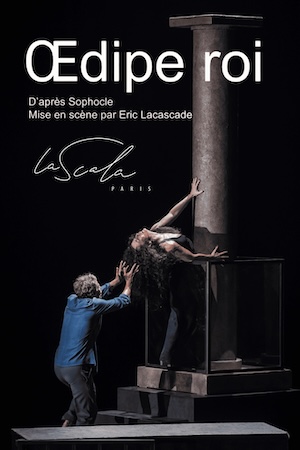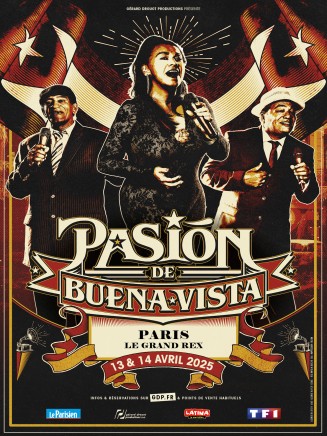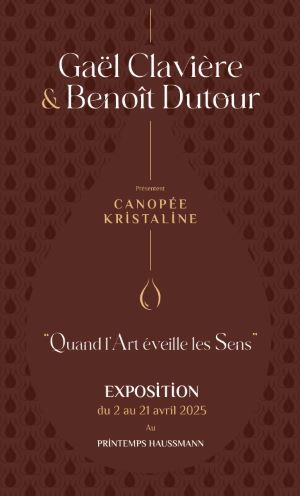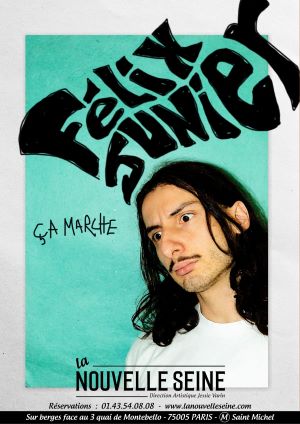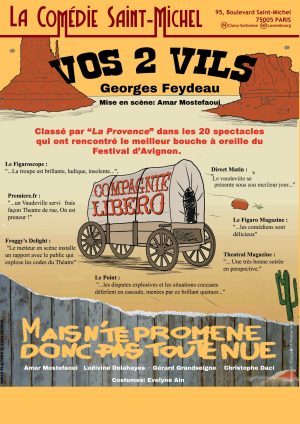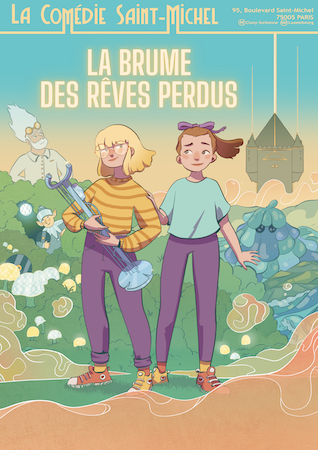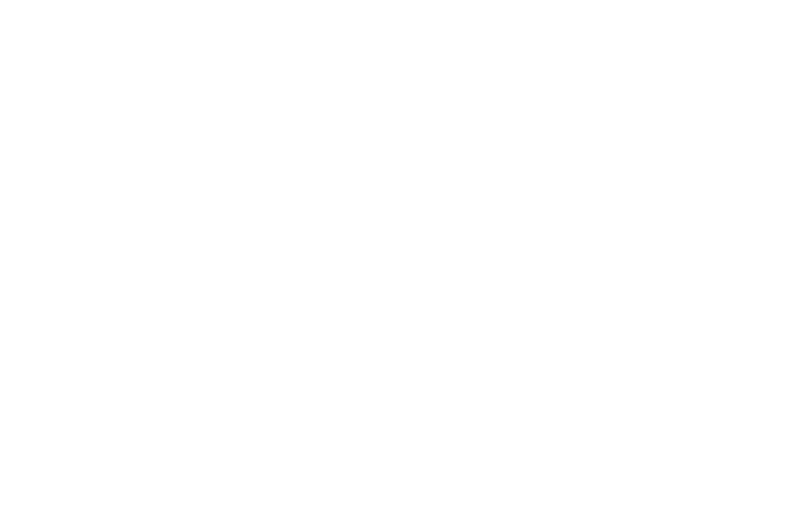La photographie allemande est-elle objective ?
Mesure exacte du monde, compte-rendu précis de la réalité, témoignage du « ça a été » selon Barthes : la photographie, « écriture de la lumière », est par définition objective. Remplaçant ainsi la peinture comme « fenêtre ouverte sur le monde », elle est d’abord, au début du XIXe siècle, une découverte scientifique. Les photographes dits de « l’objectivité » allemande, réunis autour des figures tutélaires de Bernd et Hilla Becher, professeurs à la Kunstakademie de Düsseldorf, ont un lien avec les premiers photographes : ils considèrent la photographie comme un document. Pourtant, « Objectivités », l’exposition très complète du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris démontre, à rebours de son titre, que la photographie n’est en aucun cas un médium artistique objectif.
Lorsque les Becher, à partir des années 1960, se mettent en tête de dresser des typologies de bâtiments fonctionnels, sans qualité esthétique, ils portent un regard subjectif sur des objets — châteaux d’eau, hauts-fourneaux, etc. — qu’ils photographient selon un même cadrage et avec une lumière identique, puis qu’ils juxtaposent pour former des sortes de tableaux de classification. Leur regard est supposé neutre, mais le résultat de cette empreinte froide et répétée de la réalité produit un effet substantiel sur le spectateur : les images des Becher mettent à jour la réalité de bâtiments oubliés, négligés, « invisibles », et activent ainsi une nostalgie du modernisme.
Au même moment, le peintre Gerhard Richter commence son Atlas, archivage inachevé et source iconographique perpétuelle combinant images personnelles et images trouvées, tandis que Hans-Peter Feldmann recense dans ses collages une encyclopédie du quotidien : de l’objectivité originelle surgit invariablement, chez tous les photographes présents dans l’exposition, la subjectivité, qui fait d’eux des auteurs.
De l’ambition documentaire au champ de l’art
Elèves ou non de la Kunstakademie de Düsseldorf, plusieurs photographes poursuivent à partir des années 1970 cette ambition documentaire : Candida Höfer photographie froidement les membres de la communauté turque de Hambourg, Laurenz Berges choisit de fixer le souvenir des vivants dans des maisons abandonnées, tandis qu’Ursula Schulz-Dornburg révèle l’absurdité de l’architecture soviétique dans sa série d’arrêts de bus arméniens.
Certains de ces photographes, considérés aujourd’hui comme de véritables stars, ont fait glisser leur pratique photographique vers le champ de l’art, notamment en agrandissant le format des images et en les présentant dans des caissons lumineux, sous Diasec, ou encore par des séquences en fondus enchaînés, comme le Suisse Beat Streuli, dont les portraits de passants sont autant de pistes fictionnelles. Ceux de Thomas Ruff, frontaux et hyperréalistes, évoquent les portraits peints de la Renaissance flamande, comme l’esthétique du photomaton — le visage comme identification. Dans les immenses images obsédées par le détail d’Andreas Gursky, le thème du paysage refait surface, comme chez Elger Esser, dont la photo Loir-et-Cher hérite de Corot. Lothar Baumgarten y ajoute le son pour reconstituer une impression réelle d’immersion dans un paysage avec le diaporama El Dorado 1968-1976. Chez Thomas Struth, c’est le all-over paysager ou la sociologie muséale qui sont convoqués. Autant de pistes de réflexions pour une photographie contemporaine, que l’exposition suggère brièvement, et qui démontre ce que beaucoup doivent à ces photographes allemands qui ne constituent pas pour autant une véritable « école »
Articles liés

“GRAFFITI X GEORGES MATHIEU”, avec JonOne, Lek & Sowat, Nassyo, Camille Gendron et Matt Zerfa à la Monnaie de Paris
En parallèle de l’exposition monographique des salons historiques, La Monnaie de Paris a souhaité montrer les échos de l’œuvre de Georges Mathieu dans les pratiques et les gestes artistiques de l’art urbain en invitant des artistes du graffiti de...

“Voltige” : le nouveau single du pianiste virtuose indie pop Mathis Akengin
Dès son plus jeune âge, Mathis Akengin a développé un lien profond avec le piano, ce qui l’a conduit à un parcours musical éclectique. Après des années de formation classique, il a élargi ses horizons au blues-rock, à la world-soul et au jazz, collaborant avec...

“Les Règles de l’art”, d’après une histoire vraie, en salle le 30 avril
Yonathan, expert en montres de luxe au quotidien monotone, voit sa vie basculer lorsqu’il s’associe à Éric, receleur et escroc. Fasciné par le train de vie d’Éric, Yonathan perd toute mesure. Tout s’accélère quand, pour répondre à une commande...